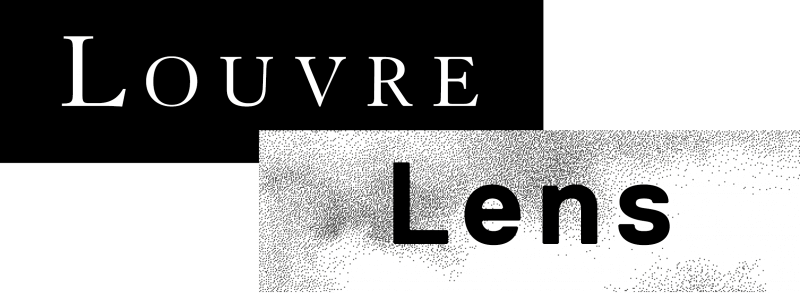D’abord, qu’est-ce qu’une scénographie ?
Vous vous direz peut-être : « Encore ce satané jargon des gens de musées ! Pourquoi faire simple si l’on peut faire compliqué ? »
Et dans ce cas, vous vous tromperez ! Originellement, ce terme se rapporte plutôt au domaine des arts de la scène. Nous n’y sommes donc pour rien ! En effet, le mot est issu de skênê, une tente ou abri sommaire que l’on édifiait sur la scène des théâtres grecs. Elle permettait aux acteurs de se changer, de disparaître et réapparaître, et l’on pouvait même les faire apparaître comme des divinités à son sommet, grâce à une espèce de grue, la mêkhanê. C’est ainsi que surgisssait le deus ex machina !

Introduction de l’exposition © Romain Delcroix / @rompicture_ sur Instagram
Pour éviter que vous n’en perdiez votre latin, voyons ce qu’en dit plus précisément le Dictionnaire encyclopédique de muséologie, publié en 2011, sous la direction d’André Desvallées et de François Mairesse (p. 660) :
« Le terme de « scénographie d’exposition », qui est d’usage plus courant que celui d’expographie (pourtant plus précis) ou de muséographie, traduit celui d’exhibition design (ou design d’exposition). Les tâches du scénographe d’exposition dépassent celles du simple décorateur ; sa collaboration demeure cependant indispensable avec le commissaire d’exposition et l’ensemble des services du musée (régie, service de médiation, etc.) »
Dans le monde des musées, un terme plus précis que « scénographie » est donc parfois utilisé. Et vous êtes officiellement autorisés à pester contre le jargon du métier : il s’agit du terme « expographie ».

Troisième section de l’exposition : « Au rythme de la nature » ©Louvre-Lens/Laurent Lamacz
Qu’en dit le Dictionnaire encyclopédique de muséologie ?
« L’expographie est l’art d’exposer. »
Jusqu’ici tout va bien.
« Le néologisme a été proposé par André Desvallée en 1993, (…) pour désigner la mise en exposition et ce qui ne concerne que la mise en espace et ce qui tourne autour, dans les expositions (à l’exclusion des autres activités muséographiques, comme la conservation, la sécurité, etc.), que ces dernières se situent dans un musée ou dans un lieu non muséal. L’expographie vise à la recherche d’un langage et d’une expression fidèle pour traduire le programme scientifique d’une exposition. En cela, elle se distingue à la fois de la décoration, qui utilise les expôts – ainsi nomme-t-on tout élément mis en exposition – en fonction de simples critères esthétiques, et de la scénographie dans son sens strict, qui, sauf certaines applications particulières, se sert des expôts liés au programme scientifique comme instruments de spectacle, sans qu’ils soient nécessairement les sujets centraux de ce spectacle. »
En résumé, la scénographie/expographie vise à traduire en espace le propos de l’exposition. Dans les musées, on a à cœur de placer les objets exposés au premier plan, en veillant à ce qu’ils n’apparaissent pas comme des décorations au sein de la scénographie. Ou de l’expographie…
Vaste programme, comme aurait dit de Gaulle.

Deuxième section de l’exposition : « La grande confrontation » © Louvre-Lens/Frédéric Iovino
Voilà en très bref pour ce qui est de la théorie. Maintenant, qu’en est-il de la pratique ?
Le programme scientifique de l’exposition… Un programme « sensible » avant tout
Cette exposition a eu trois commissaires : tout d’abord Vincent Pomarède, conservateur au musée du Louvre et brillant historien de l’art spécialiste du peintre Jean-Baptiste Camille Corot, qui est à l’origine de ce projet. Ensuite Marie Lavandier, notre ex-directrice. Et moi, dernière arrivée dans un projet plutôt ambitieux. Nous avons élaboré ensemble le contenu de l’exposition, une exposition sur le paysage, centrée sur un type de production artistique : les œuvres en deux dimensions, c’est-à-dire principalement la peinture et le dessin, et un peu de vidéo. Pourquoi ? Parce que, concernant le concept de paysage, la navigation entre réalité tridimensionnelle et construction intellectuelle et/ou bidimensionnelle est essentielle. J’y reviendrai.
Il nous importait avant tout de favoriser la rencontre entre les œuvres et nos visiteurs de tous âges et de toutes origines. Que cette petite étincelle qui se produit parfois entre une peinture et une personne soit rendue possible, alors que nous savons d’expérience que l’art de la peinture est souvent perçu comme inaccessible. Il fallait donc que cette exposition parle une langue la plus universelle possible, qu’elle touche à ce qui nous est commun.

Conclusion de l’exposition : « Réinventer la nature » © Louvre-Lens / Frédéric Iovino
Nous avions donc le choix entre l’espéranto et une approche sensible.
Nous avons choisi l’approche sensible car ce qui nous est le plus commun, c’est sans doute notre présence au monde, une expérience vécue au travers de nos sens, même si chaque être humain favorise certains sens plutôt que d’autres dans l’appréhension de son environnement. Le choix est large : vue, ouïe, toucher, goût, odorat, intuition et émotions, proprioception – c’est-à-dire la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps -, thermoception – aptitude à détecter les températures -, etc. Dans l’exposition, la vue, l’ouïe, la proprioception et les émotions viennent en premier.
Nous ne voulions surtout pas mettre en espace un cours d’histoire de l’art car cela aurait fait primer l’approche intellectuelle sur l’approche sensible. Le parcours n’est donc ni chronologique, ni typologique, ce qui ne veut pas dire que le contenu scientifique est absent. Il est juste conçu pour être perçu dans un second temps. Pour encourager une approche sensible, nous avons considéré un thème central : la création, avec un petit et un grand « C », dans sa matérialité et sa poétique. Concrètement, comment un artiste fabrique-t-il un paysage ? Comment transmue-t-il le contact qu’il établit avec la nature en une œuvre d’art ? À quoi donne-t-il alors le jour sur un plan plus symbolique ?

François Bonhommé, Mines à ciel ouvert de Blanzy, Saône-et-Loire, 1857, aquarelle sur papier, H : 85 ; L : 107 cm
Centre national des arts plastiques, en dépôt au musée des Arts et Métiers – Cnam – Paris, TP055
© Musée des arts et métiers-Cnam, Paris / P. Faligot
Ayant auparavant mené des recherches sur le paysage symboliste (fin du 19e – début du 20e siècle), je savais déjà que de nombreux artistes occidentaux pensaient leurs peintures de paysages comme des re-Créations du monde, ou plus exactement, comme une tentative désespérée de ressusciter le Paradis perdu, dans une époque où la Révolution industrielle venait brutalement redessiner au charbon les paysages qu’ils aimaient, ce qui leur donnait l’impression d’une fin du monde imminente. (« Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d’une pure coïncidence. »).
Mais quel fil conducteur serait assez puissant pour emporter le visiteur de l’entrée de l’exposition jusqu’à la sortie, en tissant ces deux questions de « fabrication » et de « re-Création » en une seule ?

La Création du monde, Maison de la Bonne Presse, 1895-1896, Plaque de lanterne magique, verre
H. 10 cm ; L. 8,4 cm, église paroissiale Saint-Pierre, commune de Sommervieu, département du Calvados, © Normandie – Inventaire général / Corbierre Pascal
Ayant cela en tête, je me suis documentée, je suis allée à la rencontre d’ouvrages dans lesquels j’avais l’intuition de peut-être trouver une réponse. C’est une publication de l’historien de l’art Florian Métral qui m’a apporté la clef de l’énigme : Figurer la création du monde – Mythes, discours et images cosmogoniques dans l’art de la Renaissance.
Merci Florian !
Dans cet ouvrage d’une érudition incroyable, quelques pages portent sur les peintres de paysage et évoquent le fait que, dès la Renaissance, « La peinture – en particulier la peinture de paysage – permet de suppléer à cette inévitable corruptibilité de la nature en la conservant, presque éternellement, dans la matière picturale. (…) le peintre est capable de reproduire, par les formes qu’il invente et les couleurs qu’il déploie, la beauté et la richesse de la création divine ». (p.71)
Si vous souhaitez en savoir plus sur le peintre démiurge, qui recrée le monde à fleur de toile, lisez l’essai de Florian dans le catalogue de l’exposition : L’art du paysage ou la création du monde. L’héritage de la Renaissance.
Notre fil conducteur trouvait donc ici de quoi se préciser et, surtout, de quoi lier la fabrication matérielle d’une peinture de paysage, dans l’art occidental, et la création d’un monde, la création d’une vision du monde, avec, comme modèle absolu, le Paradis terrestre.

Hans Steiner, Bouclier d’apparat dit « des Ribeaupierre », bois, cuir, huile sur bois, éléments métalliques, textile, fibres végétales, 1580-1590, H : 11,5 ; D : 59,5 cm : poids : 2,77 kg, Colmar, Musée Unterlinden, © Fabrice Griset @lemotographe59 sur Instagram
Le propos de l’exposition s’est donc structuré en étapes, à la façon dont la création du monde est relatée dans la Genèse, mais également dans de nombreux récits de la création du monde issus de diverses civilisations :
Introduction _ à l’origine des mondes : le parallèle entre les dieux créateurs du monde et les divins artistes.
Section 1 _ les ornements de la nature : se former, au contact direct de la nature, en étudiant des motifs comme l’arbre, le rocher, le nuage ou l’eau, donc en séparant les éléments.
Section 2 _ la grande confrontation : assembler ces motifs sur une toile afin de créer l’illusion de l’espace et du point de vue.
Section 3 _ au rythme de la nature : faire naître la lumière et les pulsations de la nature au sein du tableau.
Section 4 _ un regard théâtral : l’introduction de l’être humain devant le paysage ou son absence, et pourquoi.
Conclusion _ réinventer la nature : l’abandon de la mimésis (la représentation du visible) en faveur d’un paysage intérieur.
Une gradation, que Vincent Pomarède avait souhaitée dès le départ, s’est ainsi confirmée avec :
- des œuvres de petites dimensions au début de l’exposition et des œuvres de taille de plus en plus imposante à mesure que l’on se rapproche de la fin,
- des œuvres réalisées au plus près de la nature, puis des paysages de plus en plus construits, de plus en plus intériorisés.

Pierre Prévost, Esquisse du panorama de Constantinople, 1818, huile sur toile, H : 68,3 ; L : 859 cm, Paris, musée du Louvre © Louvre-Lens/Laurent Lamacz
Du programme sensible à la scénographie
À ce stade du travail, notre directrice a pensé souhaitable de se tourner vers un artiste contemporain pour raconter cette histoire d’un démiurge qui, en peignant des paysages, recrée le monde. Comme nos artistes du passé, il était nécessaire que cet artiste ait l’habitude de travailler au contact de la nature elle-même. Il fallait qu’il l’aime. Mais il fallait également qu’il soit à l’aise avec l’espace réel, celui des espaces d’exposition, celui où les corps bougent, se croisent, se déploient et interagissent avec les œuvres. Enfin, il fallait qu’il soit capable de travailler avec une équipe, dans la transversalité et l’écoute, tout en gardant son cap, son projet artistique.
Tout cela, et bien plus encore, nous l’avons trouvé chez Laurent Pernot.

Première section de l’exposition : « Les ornements de la nature », l’eau © Louvre-Lens/Laurent Pernot
Ce qui m’a marquée dans la première esquisse de scénographie de Laurent, c’est tout d’abord son ouverture. Je parle de la scénographie, bien sûr. Même si Laurent est tout à fait ouvert d’esprit !
Il a imaginé cette scénographie comme un paysage, comme une expérience d’immersion proche de celles que nous pouvons faire au sein de la nature elle-même, estimant primordial que le parcours du visiteur puisse être libre, comme lors d’une promenade. Peu de cloisonnement, des perspectives se révélant à tout endroit, multiples, variées, changeantes, comme dans le monde réel.
Ce parti-pris d’une exposition-paysage entre en résonance avec ce que sont au fond les idées de nature et de paysage. La nature, nous diront les anthropologues, est une construction conceptuelle humaine. Un paysage, avant même d’être représenté dans une peinture ou un dessin, est déjà une représentation. C’est la rencontre entre une portion de territoire et un regard ou un esprit qui la choisit, la distingue, la délimite, la cadre, se l’approprie, l’intellectualise, la rêve ou la fantasme.

Passage « secret » de la première à la seconde section de l’exposition, pour les enfants
© Louvre-Lens/Laurent Pernot
Cela singularise le paysage au sein des genres picturaux. Un portrait est uniquement une représentation, pas la chose en soi. En effet, le portrait représente une personne, qu’il s’agisse de son visage, son buste ou son corps entier. De même la nature morte représente-t-elle un ensemble d’objets. La peinture d’histoire représente une scène historique, mythologique ou biblique. Au contraire, un paysage représente un paysage. Ce n’est pas un portrait d’arbre – trop resserré – mais ce n’est pas non plus une vue aérienne – trop éloignée. La notion de cadrage est déjà subtilement présente avant que la peinture ne s’en mêle. Une peinture de paysage est donc la représentation d’une représentation. C’est une mise en abyme.
Qu’est-ce qu’une mise en abyme ?
Selon l’encyclopédie Universalis en ligne, l’écrivain André Gide a popularisé cette expression issue du domaine de l’héraldique. En 1893, il écrit « J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre. Rien ne l’éclaire mieux et n’établit plus sûrement toutes les proportions de l’ensemble. Ainsi, dans tels tableaux de Memling ou de Quentin Metsys, un petit miroir convexe et sombre reflète, à son tour, l’intérieur de la pièce où se joue la scène peinte. » Un tableau dans un tableau, en quelque sorte.
Revenons à l’exposition et à sa scénographie. Un paysage est une représentation. Une peinture de paysage est la représentation d’une représentation. Notre exposition-paysage est donc, d’une certaine manière, la représentation d’une représentation d’une représentation. Le cadrage d’un cadrage d’un cadrage. Et, plus certainement encore, une création au sein de laquelle sont exposées des créations qui se réfèrent à la Création, tout du moins pour ce qui est des œuvres occidentales.
Vertigineuse, cette mise en abyme, n’est-ce pas ?

Alexandre-François Desportes, Paysage et animaux, entre 1661 et 1743, huile sur papier, H : 32 ; L : 52 cm, Sèvres, Manufacture et Musée , dépôt à Lille, Palais des Beaux-Arts © RMN-Grand Palais (PBA, Lille) / Stéphane Maréchalle
Il me semble que ce parti-pris scénographique révèle, par le traitement de l’espace et le mode d’exposition des œuvres, ce qu’expriment les mots de la philosophe Justine Balibar, spécialiste du paysage :
« on pourrait envisager le paysage comme cette hésitation, cette tension essentielle entre réel et représentation. D’un côté, paysage peint et paysage réel sont séparés par une distance ontologique infranchissable, celle qui distingue un espace visuel en deux dimensions d’un espace polysensoriel en trois dimensions. D’un autre côté, ces deux modalités du paysage semblent se faire mutuellement écho, s’incliner l’une vers l’autre comme si elles tendaient à se rejoindre, à se confondre, comme si elles se manquaient l’une à l’autre. »
Vous pouvez retrouver cet extrait dans l’essai de Justine inclus dans le catalogue de l’exposition et intitulé Le paysage, une invention des peintres ? (p. 32)

Introduction © Louvre-Lens / Laurent Lamacz

Deuxième section © Louvre-Lens / Frédéric Iovino

Deuxième section © Louvre-Lens / Laurent Lamacz

Troisième section © Louvre-Lens / Laurent Lamacz

Quatrième section © Louvre-Lens / Laurent Lamacz
La scénographie de Laurent Pernot joue sur cette ambiguïté au cœur de la notion de paysage, cette oscillation entre réel et représentation. Tout au long de la galerie d’exposition, l’éclairage et la couleur des cimaises (les parois sur lesquelles sont accrochés les tableaux) évoluent. Ils rappellent ainsi que dans la nature, à l’extérieur, les paysages ne sont pas figés. Ils évoluent dans le temps, sous l’action de la lumière, des saisons, de l’action et du regard humains.
Les cimaises passent du noir de la nuit, aux couleurs chaudes de l’aurore, puis à celles plus froides de la matinée, pour revenir, à la fin, au noir. Les dialogues entre les teintes choisies et les œuvres révèlent la qualité des tableaux, de leurs gammes chromatiques, de leur matière picturale et de leurs compositions. Les formes des cloisons passent graduellement de rondeurs organiques et sculpturales à des silhouettes plus géométriques. Elles évoquent ainsi également l’histoire du monde, de sa naissance à nos jours, du Big Bang à l’Anthropocène.
Ces couleurs sont accompagnées, par endroits, de diffusions sonores correspondant elles aussi à une gradation : le son « blanc » du groupe M83 est suivi du pépiement des oiseaux ou du chuintement des vagues. Ces sons « bruts » ou « naturels » laissent place, à la fin de l’exposition, à des sons plus complexes, par exemple à l’ode Welcome to all the pleasures de Henry Purcell (1683) où la voix d’un contre-ténor fait son apparition.

Dispositif spécifique d’éclairage d’un tableau, Henry Brokman, Tombeau du marin (Style romantique), 1910, huile sur toile, H : 75,5 ; L : 119,5 cm, Paris, Musée des beaux-arts de la ville de Paris – Petit Palais © Romain Delcroix – @rompicture_ sur Instagram
Enfin, un dispositif spécifique d’accrochage des tableaux est proposé à six reprises. Les tableaux choisis par Laurent Pernot sont présentés dans des niches rectangulaires aux dimensions pensées sur mesure pour chacun d’entre eux. À l’intérieur, un système de LED dispense un éclairage dont le timing et la teinte ont été réfléchis par Laurent en fonction des particularités de l’œuvre. Ce scénario lumineux donne l’impression que le tableau vit, accentuant l’effet d’illusion des perspectives atmosphériques et linéaires.
Lorsque j’ai découvert cette proposition de Laurent, lors de la présentation de sa première esquisse, j’ai tout de suite été intriguée par cette idée. Ces tableaux placés dans des niches éclairées me faisaient penser à des reptiles placés dans des vivariums, comme si ces peintures étaient bien vivantes. La proposition est audacieuse ; elle nous oblige, nous personnels de musées, à sortir de notre zone de confort pour prendre le risque d’une présentation inhabituelle, loin d’un éclairage considéré peut-être à tort comme « neutre ». La neutralité est toujours relative, ce qui est considéré comme neutre aujourd’hui ne le sera plus demain.

Dispositif spécifique d’éclairage d’un tableau, Marie Anatole Gaston Roullet, La baie d’Along (Tonkin), le cimetière des transports français « Gironde » et « Nièvre », 1885, huile sur toile, Paris, Musée de l’Armée © Louvre-Lens / Laurent Lamacz
Je perçois dans ces dispositifs trois intérêts principaux. Ils permettent de sensibiliser les visiteurs au fait que les paysages peints par les artistes n’étaient pas figés ; chaque œuvre tend plus ou moins à traduire un instant éphémère, sauf dans le cas de certains paysages idéalisés, comme ceux du Paradis ou de l’âge d’or. Chaque œuvre tente donc de donner l’illusion d’une peinture prête à prendre vie.
C’est particulièrement pertinent pour le genre du paysage, qui traite d’un concept en tension perpétuelle entre réel et représentation.
Le second intérêt est justement de rappeler qu’un tableau, pas plus qu’un paysage, n’est totalement figé. Les œuvres nous parlent à travers le temps, elles vivent grâce au regard contemporain et sensible que nous portons sur elles. Enfin, ces dispositifs peuvent également amener les visiteurs à réaliser que, justement, ces tableaux ont traversé le temps et ont été éclairés de manières variées, depuis l’espace où ils ont été peints (parfois en partie sur le motif, c’est-à-dire en extérieur, face au modèle) jusqu’à celui où l’œuvre est maintenant exposée.
Pour en savoir davantage sur la réflexion que Laurent Pernot a mené sur cette scénographie « atmosphérique », vous pouvez lire son essai dans le catalogue de l’exposition. Il est intitulé Entre terre et ciel (p. 16 à 23).

Victor Hugo, Ma destinée, 1857, plume, encre brune et gouache blanche sur papier vélin, H : 17,2 : L : 26,4 cm, Maisons de Victor Hugo, Paris / Guernesey © RMN-Grand Palais / Agence Bulloz
Tout en étant une œuvre en soi, la scénographie de Paysage. Fenêtre sur la nature remplit donc bien la mission définie dans le Dictionnaire encyclopédique de muséologie ; elle constitue un langage grâce auquel le propos sensible de l’exposition est rendu accessible. Les œuvres n’y constituent ni des décorations, ni des instruments de spectacle. Elles sont en quelque sorte réactivées, mises en vibration, dans cette tension entre réel et représentation qui fait toute la richesse et l’intérêt du concept de paysage.
Par les gradations qu’elle instille tout au long du parcours, la scénographie active l’histoire que nous souhaitions raconter, cette création d’un monde-paysage en quatre étapes par l’artiste démiurge. Ce Créateur n’étant rien d’autre qu’un avatar de l’être humain, la confrontation avec les peintures de paysages, avec leur recherche parfois paradoxale d’éphémère et d’incorruptible, peut éventuellement amener à un questionnement d’actualité : face au monde, sommes-nous des démiurges surplombants, dominants, qui séparent les éléments pour les recombiner à notre goût, ou bien des créatures parmi tant d’autres, qui doivent tenter de comprendre les choses de l’intérieur et se re-lier à elles ? Où trouver la juste mesure entre un recul propice à l’analyse et une fusion/immersion gage de sympathie ?