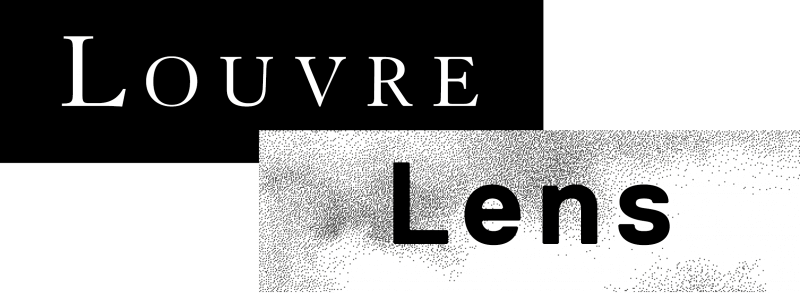Politique de confidentialité :
Vous pouvez utiliser notre site et notre application sans avoir à décliner votre identité ni fournir des informations personnelles vous concernant. Cependant, vous pouvez être amené(e) à fournir des informations personnelles dans le cadre du formulaire de contact ou d’abonnement à la newsletter.
Collecte des données à caractère personnel :
Vos données personnelles peuvent être collectées lors de la navigation sur ce site Internet.
De même, les messages électroniques envoyés au Louvre-Lens et les adresses électroniques utilisées pour l’envoi d’informations complémentaires sont susceptibles d’être conservées.
Les informations recueillies à travers notre site et notre application font l’objet d’un traitement informatisé.
Les informations personnelles recueillies sur la base de votre consentement sont vos :
– Prénom
– Nom
– Adresse électronique
– Numéro de téléphone
Le Louvre-Lens s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril et à la loi Informatique et Libertés modifiée du 6 janvier 1978.
Les durées de conservation sont définies de manière proportionnées aux finalités.
Droits
Conformément au RGPD et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la protection des données en cliquant ici. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.
En application des articles 38, 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez, gratuitement, d’un droit d’accès, de rectification, de modification et d’opposition aux données qui vous concernent ou concernent les personnes décédées dont vous êtes les ayants-cause. Si vous souhaitez exercer ce droit vous pouvez vous adresser à la rédaction du site par courrier à l’adresse ci-dessus.
En tant que consommateur, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL.
Liens hypertextes :
Le site du musée du Louvre autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son contenu dès lors qu’il ne crée pas de confusion sur la source des services et/ou contenus produits et/ou détenus par le musée du Louvre-Lens et sous réserve de :
- ne pas utiliser la technique du lien profond (« deep linking »).
- mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé.
Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
Attention ! Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre ; et aux sites internet portant atteinte aux intérêts matériels ou moraux du musée du Louvre-Lens.
Cookies :
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer les informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr. L’utilisateur dispose de l’ensemble des droits susvisés s’agissant des données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.
Collecte des données à caractère personnel :
Vos données personnelles peuvent être collectées lors de la navigation sur ce site Internet ou lors de la soumission des formulaires.
Pour modifier ou supprimer vos informations personnelles, veuillez faire la demande sur notre formulaire de contact.