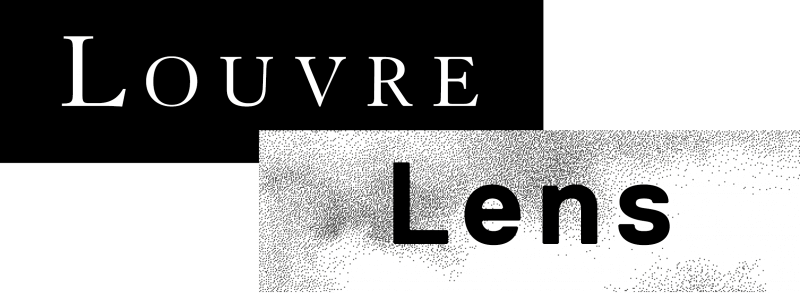Henchir el Attermine (Tunisie actuelle) Fragment de relief architectural montrant des divinités égyptiennes, remployé comme dalle funéraire chrétienne, vers 160 après J.-C., marbre, H. 1,92 ; l. 0,83 m, Paris, musée du Louvre, achat, 1912 © RMN-GP (musée du Louvre) / Hervé Lewandoski
Ce relief nous emmène à l’évidence dans l’Antiquité classique : en témoignent la gestuelle naturelle et élégante des personnages, la nudité de quelques modèles masculins, ainsi qu’un talent consommé pour la réalisation des plissés des vêtements.
Mais grec ou romain ? À moins d’être spécialistes, quand les figures incarnent vertus ou divinités, bien souvent, seul le cartel nous renseigne. Pourquoi cette confusion ? Après avoir vaincu et intégré dans son territoire les royaumes hellénistiques (146 av. J.-C. – 330 ap. J.-C.), le monde romain s’est approprié la religion grecque (Zeus ou Jupiter, qui peut le dire ?). D’autre part, fascinés par la culture hellénistique, les sculpteurs romains sont alors totalement acquis à l’art grec, qu’ils copient abondamment.
Le cartel indique une datation d’environ 160 ap. J.C. C’est sûr, c’est romain (époque de Marc Aurèle) ! Mais, en fait, là commencent nos véritables ennuis : certes d’époque romaine, mais en provenance d’un site tunisien, ce relief représente des divinités d’origines différentes, grecque et égyptienne, et a été remployé (autrement dit : réutilisé) comme dalle funéraire chrétienne !
Quel bouillon de cultures !!!
La femme – Elle pourrait être une femme romaine ordinaire : elle porte les trois vêtements traditionnellement associés, soit une tunique, une robe (la stola) enroulée autour du corps et un long châle frangé jeté sur les épaules (la palla). Mais elle présente également tous les attributs d’Isis : dans sa main droite, elle tient le sistre (crécelle rituelle associée au culte des déesses), au front et en modèle réduit, elle arbore la couronne hathorique amonienne, et pour maintenir son vêtement, un beau nœud, le nœud d’Isis.
La couronne hathorique amonienne était constituée du disque solaire de Rê (père d’Isis), placé entre les longues cornes de la vache Hathor (la déesse mère par excellence) placé au-devant des deux hautes plumes de la coiffe d’Amon de Thèbes, dieu protecteur de la royauté égyptienne.
En histoire de l’art, cette image d’Isis gréco-romaine est dite Knotenpalla (palla au nœud). Donc, il s’agit d’une image romaine d’Isis, déesse née aux temps pharaoniques les plus reculés (vers 2450 av. J.C.) et incarnant le pouvoir divin de la mère royale, qui transmet le sang divin à l’héritier.
Quelques 2300 ans plus tard, ces attributs ont quelque peu changé d’allure !
À part le sistre, la couronne n’est plus qu’un souvenir et le nœud n’a plus rien à voir ! À partir de 1300 av. J.C, les reines du Nouvel Empire la portent parce qu’elle symbolise leur fonction d’Isis régnante. Quant au nœud, si sa forme est totalement grecque, et qu’il n’a plus rien de commun avec le nœud égyptien, appelé tit, la symbolique est strictement la même : emblématique de la féminité, il s’agit du nœud qui ferme la robe des femmes (peu importe la mode !).
Mais la figure d’Isis n’a pas été inventée seule : une mère a besoin d’un époux pour faire valoir le fils ! Son rôle est de garantir la nature divine du sang royal ; elle est donc l’épouse de son frère, Osiris, le premier des fils de Rê à avoir régné sur la vallée. Osiris est le père posthume de leur fils Horus (posthume, parce qu’assassiné par son propre frère Seth !). Osiris symbolise alors l’éternité de la royauté par-delà la mort terrestre, et ce, grâce à l’œuvre de son fils Horus, qui continue de régner sur terre en son nom.
Pouvoir divin de la légitimité royale, les figures de cette triade – Isis, Osiris et Horus – sont anthropomorphes, associées visuellement à la famille royale.
L’enfant – Horus ne prend son allure de faucon que lorsqu’il a grandi et qu’il règne. Tout petit, il est représenté enfant et Harpocrate n’est que la transcription grecque du mot égyptien Hor pa chered « Horus l’enfant ». L’iconographie s’inspire totalement des critères pharaoniques : nudité, mèche de l’enfance, doigt porté à la bouche. Une chose pourtant le différencie de l’Harpocrate égyptien : il tient la corne d’abondance pleine de raisins, symbole grec de vie et de fertilité.
Quant au papa, il change de nom ! Osiris devient Sérapis. Les Grecs qui s’installent en Égypte au début du 3e siècle av. J.C., rencontrent, à Memphis, le culte au taureau Apis, incarnation sur terre de la puissance divine de la force de cohésion sociale du roi. Difficile pour un roi grec de se faire passer pour un taureau ! Et si cette forme divinisée du pouvoir était rendue éternelle dans l’Au-delà, dans la personne d’Osiris (un être humain normal) ? C’est ainsi qu’Apis est devenu Osiris-Apis (oueser-hâpi en égyptien), ce qui par contraction est devenu Sérapis. Il porte la chevelure abondante et la barbe fournie des dieux principaux du monde grec, Zeus de l’univers, Hadès des Enfers et Poséidon des mers. Mais pour affirmer sa fonction nourricière du peuple, il porte sur la tête le kalathos (en grec) devenu modius en latin, qui est le pot de mesure des céréales.
Les rois grecs d’Égypte, les Ptolémées (332-30 av. J.C.), placent alors leur pouvoir sous la protection divine de la triade Isis-Harpocrate-Sérapis.
Mais pourquoi quatre à la triade ?
Il manque la moitié du personnage de droite, mais on peut l’identifier grâce à son attribut, le thyrse. Ce long bâton avec un ruban noué, et dont le pommeau oblong est en fait une pomme de pin, est le sceptre de Dionysos. Or ce dieu là, les Grecs le connaissent bien ! Il détient le secret de la régénération éternelle de la nature dans le monde des vivants. Ceux qui acceptent de le suivre seront initiés au secret et participeront de cette revivification dans les cérémonies des dionysies. Animant l’éternité dans le monde terrestre, il a donc toutes les raisons d’être associé à Sérapis, symbole de l’éternité dans l’Au-delà.
D’ailleurs, est-on bien sûr que les Grecs faisaient valoir la triade égyptienne ?
Recette pour un bon bouillon de cultures : les migrations divines
La religion dionysiaque est la première des religions à mystères (destinées aux seuls initiés) connues dans le monde grec. Les premières mentions des dionysies remontent au 6e siècle av. J.C. Certes Isis connaissait les secrets de la vie bien avant (n’a-t-elle pas conçu son fils avec le corps de son défunt mari quelques 2000 ans plus tôt ?). Mais en Égypte, le mystère reste entier et confié à la seule royauté assistée de prêtres. Ici point d’initiés, tout le monde a droit à la survie dans l’Au-delà, du moment que le tribunal d’Osiris admet que votre comportement terrestre n’a pas mis en péril la création originelle de Rê. Pas d’initiation, donc pas de profession de foi pour signifier son adhésion au culte !
En fait, chez les Égyptiens, on n’a pas besoin de se demander s’il faut croire, on le sait !
Progressivement, le culte isiaque va lui aussi se transformer en religion à mystères. Son caractère ancestral et commun à toutes les cultures (celui de la déesse mère), lui assure un grand développement : d’abord dans le monde grec, puis dans l’Empire romain, qui avait d’ailleurs adhéré aux rites dionysiaques sous le nom des bacchanales.
Au début, c’est compliqué, le royaume ptolémaïque (après sa conquête par Alexandre le Grand, en 322 av. J.-C., l’Égypte fut dirigée par 14 souverains successifs appelés « Ptolémée », dont la plupart des épouses s’appelèrent « Cléopâtre ») est le dernier à résister à la conquête romaine, Cléopâtre VII ayant joué de tous ses charmes pour tenter d’éviter l’inévitable. Après avoir conquis le cœur de Jules César, puis celui de son allié Marc Antoine, Octave – le futur Auguste premier empereur, se méfie de l’Égypte comme de la peste. Mais tout commence à s’arranger à partir de Caligula, qui rêve d’être pour Rome, le dieu que les Égyptiens voyaient en leur roi. Certains empereurs vont jusqu’à se placer sous la protection de la triade ptolémaïque : à Tivoli, on trouve un serapeum, temple dédié au culte de Sérapis, dans la villa d’Hadrien (117-138). Donc rien d’étonnant à ce que notre relief daté de 160 ap. J.C. associe ces deux cultes à mystères essentiels.
Oui mais en Tunisie, quand même !
Quand le Louvre a acheté ce haut relief en 1912, le marchand avait assuré qu’il venait d’Alexandrie, la capitale ptolémaïque. Mais, selon une enquête de la Direction des Antiquités (1913-1914), il a d’abord été entreposé à Malte et proviendrait de Henchir el-Attermine, site archéologique de Tebura, ancienne cité romaine de Thuburbo Minus, à l’ouest de Tunis. Certains ont voulu mettre en doute cette provenance, car, s’il était intégré à l’Afrique conquise par les Romains, le site n’avait jamais produit d’œuvres de cette belle qualité. Cependant, les archéologues ont découvert de nombreux remplois (réutilisation d’œuvres ou de matériaux) antiques dans les constructions modernes et l’on sait que la cité connaît un réel épanouissement jusqu’au début du 3e siècle ap. JC.
Par ailleurs, notre relief n’a pas attendu la période moderne pour être remployé : au revers, une inscription chrétienne, signalée par le chrisme (premières lettres croisées du mot Christ en grec, X et P), est rédigée en latin. Or, en Égypte, on a continué de parler grec jusqu’aux invasions arabes du 7e siècle ap. J.C. La christianisation de la Tunisie a suivi le cours de celle de l’empire : une sortie de la clandestinité par l’édit de tolérance de Constantin en 313, puis la consécration en religion d’État par l’édit de Thessalonique en 380 par Théodose 1er, qui impose la version du christianisme établie au concile de Nicée en 325, « je crois au Père, au Fils et au Saint Esprit ».
On peut lire « AG. GA FIDELIS IN PACE VIXIT AN-NOS XL M(en)S II », soit le nom du défunt, « Agrius Gaius ?, fidèle, en paix, a vécu 40 ans (et) 2 mois ». Cette épitaphe est datée du 5e siècle ap. J.C. et l’inscription est assez maladroite. Elle a dû être gravée pour une personne de petite condition car, dès le début du 5e siècle, la cité était un évêché organisé et rattaché à l’archevêché de Carthage.